Il nous faut revenir sur une gigantesque révolution silencieuse : celle des professionnels des pompes funèbres depuis trente ans. Cette modification est passée presque inaperçue. La société n’en a pas conscience. Les politiques en général ne s’en occupent guère – et ne cessent d’insister sur les réglementations, le prix des prestations, les "devis" en mairie, sans prendre toute la mesure des nouvelles responsabilités qui incombent désormais aux professionnels. Quant aux professionnels eux-mêmes, ils ne veulent pas aller jusqu’au bout de ces mutations, s’organiser en conséquence, accepter de faire "la police" (avec, par exemple, un "Ordre des opérateurs funéraires" – sur le modèle de "l’Ordre des médecins") pour faire sanctionner les "brebis galeuses" qui, même en tout petit nombre, nuisent à l’image de la profession et alimentent les gazettes au moment de la Toussaint. Il faudrait faire de vastes "états généraux des professionnels du funéraire" pour mettre à plat bien des problèmes, les exposer aux pouvoirs publics, y apporter des solutions internes, établir les bases d’une nouvelle ambition professionnelle et se doter des moyens pour y parvenir. Il le faudrait, pour autant que les professionnels le souhaitent réellement. Tout est là.
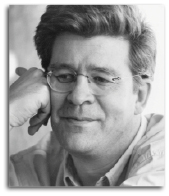 |
| Damien le Guay, philosophe, président du CNEF. |
Les pompes funèbres, qui sont moins pompeuses qu’autrefois, moins arrimées au religieux, moins réglées comme "du papier à musique" (et donc plus à la carte), doivent désormais assumer des tâches plus nombreuses, plus compliquées, à la frontière de la religion, des "services publics" afin de se mettre à la disposition de familles qui, pour l’essentiel, ne savent plus bien ce qu’elles veulent même si elles attendent beaucoup. Il y a donc un nouveau devoir : celui de la co-construction de l’offre funéraire entre les familles et les professionnels. Un nouveau devoir s’est imposé : conseiller avec justesse, ne rien brusquer sans rien oublier, expliquer tout en apportant les "premiers soins du deuil". Tout cela prend du temps. Du temps (qui n’est jamais reconnu comme tel) et suppose une "qualité d’écoute", un don d’empathie et un professionnalisme maintenu.
Je me propose ici de poser les bases anthropologiques de cette invisible mais gigantesque révolution funéraire. (Dans un autre article, sans doute faudra-t-il aborder des questions relatives à la profession elle-même, à son organisation.) Cette révolution vient interroger le nouvel idéal moderne de la mort – que nous connaissons tous : idéal d’une mort inconsciente, silencieuse, aphone, seul, sans accompagnement, éloigné des vivants pour éviter, en quelque sorte, de trop "contaminer" le monde des vivants. Cet idéal, qui conduit, en bout de chaîne, à la crémation, est donc celui d’une mise en quarantaine du funéraire. Quarantaine, comme s’il fallait éviter une épidémie de chagrin, de mélancolie et d’un deuil trop long avec des perturbations psychologiques trop importantes. Nous n’avons plus collectivement conscience d’une responsabilité vis-à-vis de la mort. Il nous faut donc nous en débarrasser au plus vite – comme un serpent se sépare de sa peau morte pour passer à autre chose.
Aujourd’hui, pour être indifférents à la mort en général (et à sa mort en particulier), nous sommes incapables de la quitter – comme s’il s’agissait d’un vêtement –, de la donner en héritage, de la partager. Comprenons-nous bien ! Les séparations sont, pour qu’elles soient effectives, faites de part et d’autre. La séparation est toujours au pluriel. Jusqu’alors, la mort nous quittait et, par les rites funéraires, nous quittions la mort qui nous avait quittés. Le deuil prolongeait la séparation de la mort. Or, de nos jours, la vie nous quitte sans que nous souhaitions, de notre côté, quitter la mort. La séparation se fait à notre insu, malgré nous, sans désir de séparation. La "préparation" suppose (ou supposait) d’accepter par avance les cérémonies, les partages, les perturbations, les gênes en cascade. Pour donc refuser cette préparation, et donc cette anticipation et donc cette prise de conscience d’une séparation nécessaire et volontaire (alors qu’elle est, aujourd’hui, seulement inéluctable), nous sommes aujourd’hui en quelque sorte dépouillés de la mort – qui nous est devenue étrangère. Avant, elle s’assumait, se partageait et donc se donnait, en quelque sorte. Aujourd’hui, pour la refuser corps et âme, nous acceptons seulement le vol. Nous sommes passés d’une mort-divorce à une mort-dérobade qui intervient par effraction. Nous sommes passés d’une négociation pénible et faite dans la douleur à un vol souhaité pourvu qu’il intervienne le plus rapidement possible. Avant, nous étions en quelque sorte propriétaires d’une mort qui nous dépouillait de nous-mêmes. Avec cette appropriation, la mort devenait "notre" mort – ou tendait à l’être. Dernier effort de singularisation, de personnalisation avant de tomber dans l’anonymat des corps en décomposition et des espérances en un au-delà collectif. Aujourd’hui, nous sommes possédés par la mort. Double anonymat : de la mort et des croyances.
Qui donc, aujourd’hui, a encore conscience de devoir imposer sa signature aux derniers instants de la vie ? Mais, me direz-vous, l’anonymat est la règle de notre humanité. Il y a là justement conflit : ce qui est anonyme se doit d’être approprié par notre humanité singulière. Les fleurs deviennent des bouquets, les arbres un arbre, les femmes une femme. Toujours, tout le temps, nous nous approprions des réalités anonymes devenues singulières. Si cet effort ne se faisait pas (s’il n’était pas imposé), nous serions en trop dans un monde à ce point anonyme qu’il serait comme une toile cirée sans la moindre aspérité. Telle est la conséquence ultime du nihilisme : ne pas faire de différence, niveler les valeurs, promouvoir une indifférence de tous vis-à-vis de tout pour, in fine, donner plus de valeur au monde dans lequel nous sommes plutôt qu’à ceux qui l’habitent. Que dire de la condition humaine sinon qu’elle est un travail constant d’adhésion au monde, d’attachement aux choses, d’agrafage des uns aux autres ? Elle est donc une lutte contre l’indifférence pour éviter d’avoir le sentiment d’être quantité négligeable dans un monde fermé sur lui-même et sans la moindre aspérité à laquelle s’agripper – comme autant de bouées de sauvetage dans le grand naufrage annoncé qu’est notre vie. De deux choses l’une : soit nous finissons par être superflus dans un monde trop inhospitalier pour nous recevoir, soit nous trouvons notre place, la nôtre, notre juste place, dans un monde accueillant.
Ce qui s’opère avec la mort (son anonymat progressif) s’opère avec la vie
L’effort de personnalisation, qui fait d’une fleur "sa" fleur, d’une musique, la sienne, et d’une vie "comme les autres" une vie hors du commun, tend à s’évanouir. Cet effort est de plus en plus difficile. Qui en profite ? Bien entendu, le processus marchand, qui offre des singularités par les marques. Quand la conscience d’être un individu singulier avec sa valeur propre s’évanouit, la socialisation par la marque marchande devient légitime. Il nous faut prendre conscience de cette nouvelle alternative : soit nous nous démarquons par nous-mêmes soit, incapables de le faire, nous nous faisons re-marquer par les marques de luxe. Disons-le autrement : soit "je est un autre" soit "je est une marque". Et donc, si le souci de personnalisation est rendu difficile, naît une conscience d’un nécessaire et inévitable anonymat. Au bout du bout du désir d’incognito (désir par défaut, mais désir puissant, social, impérieux), n’y a-t-il pas un désir de cendres ? Si le corps est propre à chacun, les cendres, elles, sont l’expression même de cette mort "anonyme". Les corps se reconnaissent. Les cadavres aussi. Les cendres, elles, n’ont plus de signes d’identification. Elles n’appartiennent plus à personne en particulier. Il nous faut donc considérer (telle sera notre hypothèse de travail) ce désir de cendres, ce souhait d’effacement, comme la conséquence ultime d’un échec social de singularisation.
Définissons la socialisation comme une sortie hors de l’informe, une mise en forme de nous-mêmes et de nos désirs, la perte de l’anonymat au profit d’une distinction. Le corps, donc, même s’il est en voie de corruption naturelle, reste ce que nous avons de plus singulier. Nous nous reconnaissons les uns les autres par le corps : le visage, le regard, la physionomie générale. Nous nous aimons par les corps. Nous nous désirons en corps et en âme. Avec les cendres, tout disparaît – y compris l’ADN, la corpulence, les os, le grain de peau, les traits du visage…
Au nom de quoi revenir sur cet idéal moderne d’un dérangement le plus petit possible ?
Pourquoi ? Telle est l’interrogation, formulée de diverses façons, quand il s’agit de remettre en cause ce nouvel idéal d’une mort in-acceptée et inacceptable. Au nom de quoi ? Après tout, ce que les gens décident, ils le décident – surtout quand il s’agit de leur mort. Interroger cet idéal et ces pratiques, n’est-ce pas souhaiter revenir, sans le dire, "aux funérailles d’antan" avec les chevaux en noir, les veuves en noir, les pompes grandiloquentes des "pompes funèbres", qui, aujourd’hui, ont disparu au profit des "services funéraires" ? Mais, comme le dit à juste titre Georges Brassens : "Elles ont fait leur temps, les belles pompes funèbres de nos vingt ans." Les pompes ont disparu et avec elles les funérailles du temps jadis. C’est ainsi.
Dès lors, une question se pose : au nom de quoi ou de qui en revenir ou en rester aux temps anciens du funéraire où la mort était plus belle ? Est-ce pour des raisons religieuses pour redonner un sens aux communautés défuntes et reprendre en main ces cérémonies mortuaires qui se sont de plus en plus "laïcisées" ? Ces raisons ne sont pas pertinentes. Il n’y a pas de retour en arrière possible. Et les raisons qui ont promu cette esthétique de la mort ou les pompes religieuses d’antan ont disparu. La fin de la "mort sociale" est liée avant tout avec la fin des communautés, la disparition de la conscience de "faire groupe" les uns avec les autres. Ce qui n’est plus n’est plus. Il ne s’agit pas d’altérations faute d’entretiens, de dégradations sociales partielles (comme une maison qui tombe en ruine et qui pourrait être rebâtie si des travaux de consolidation étaient entrepris), mais d’un changement complet de modèle. Nous sommes passés dans un autre monde, un nouveau monde centré sur l’individu qui aspire tout à lui plutôt qu’il n’est aspiré par le monde. Ce qui autrefois nous tenait, ne nous tient plus. Ce qui était solide est désormais liquide – selon la belle analyse de Zygmunt Baumann. Nous sommes passés d’un monde d’ancrages successifs, cumulatifs, ajoutés les uns aux autres, et ce, pour donner corps à la société, à un monde désentravé où l’individu flotte en quelque sorte à la surface de lui-même, emporté sur les eaux d’une mondialisation tempétueuse, incertaine, angoissante. Les digues ont sauté. Les frontières aussi. La crainte de l’enfermement a pris le pas sur l’invention de soi par soi. L’individu reste seul à seul avec lui-même, empêtré dans une inédite liberté sans entrave, sans frein, sans interdit, soucieux de se délier, mais tout en éprouvant, au fond de lui, une sorte de nostalgie de coagulation.
Dès lors, il faut en revenir non aux pratiques mais aux raisons mêmes de la mise en commun de la mort d’autrui, au partage social d’un cadavre. Certains croient que ces décorums étaient et demeurent superflus, que ces pompes étaient et sont toujours ostentatoires, que ces rites sont liés, aujourd’hui comme hier, à la seule emprise de la religion sur les consciences. Ceux-là, ayant trop de comptes à régler avec la société ancienne (ou, pour diverses raisons, avec la religion), ne s’interrogent pas sur le "pourquoi du comment". Pourquoi l’esthétique ? Pourquoi un funéraire mis en partage ? Pourquoi ce désir d’être relié (religion) les uns aux autres pour mieux se comprendre et donner sens à ce que nous vivons et à notre vie même ? Pourquoi ?
Partons, pour bien comprendre le "pourquoi du comment", du malaise, de la mal-façon de mourir – ce que nous nommons des "deuils mal faits". Ceux-ci existent. Ils sont une réalité psychologique, sociale, humaine. Si ces deuils sont mal faits c’est qu’il est possible de "bien" les faire, de "mieux" les faire. Mais encore faut-il que cette mal-façon existe et ne soit pas une manière d’inventer un mal supposé pour défendre je ne sais quelle manière ancienne et remise en cause par les avancées de la modernité. Car, pour certains sociologues, tout se jouerait là : dans l’opposition entre d’anciennes pratiques (liées à l’ancien monde où la religion réglait d’une manière impérative la vie quotidienne dans ses moindres détails) et de nouvelles liées à la façon moderne de vivre sa vie et donc sa mort. Remettre en cause cette façon moderne de mourir équivaudrait à remettre en cause la modernité elle-même. Ainsi, Danièle Hervieu-Léger considère qu’existent des configurations spécifiques, des ritualités différentes selon les phases de civilisation. Ces configurations génèrent des "comportements spécifiques". D’où "différentes configurations du mourir" qui, en soi, ne sont pas meilleures les unes que les autres.
Aujourd’hui, avec une double logique d’atomisation et de subjectivisation, qui sont l’apanage de notre actuelle modernité, "mourir en sujet, c’est consentir à mourir seul" : "c’est par "petits bouts", au travers de petits récits tâtonnants et d’expérimentations rituelles précaires, que nous sommes amenés à en produire le sens, pour nous-mêmes et pour nos proches. Cette configuration n’est ni "vide", ni plus "pleine" que toutes les autres configurations repérables dans l’Histoire. Elle n’est pas, en tout cas, moins porteuse de grandeur humaine". Si donc, nous voulons mourir en sujet moderne, nous devons accepter de mourir seuls. Il n’y aurait pas de deuils mal faits, mais seulement des configurations historiques différentes, et la nôtre ne serait pas moins "pleine" que les autres avec un "autre univers de croyances" qui, grâce à "la multiplication des petits bricolages qui permettent aux individus de produire, pour eux-mêmes, le sens de la précarité de leur condition".
Or (et nous voudrions repartir de là) existe une nouvelle prise de conscience : celle d’une mal façon de mourir. Déjà en 1975, Philippe Ariès, l’historien de la mort, après avoir constaté une augmentation de la "mortalité des veufs ou des veuves dans l’année suivant la mort du conjoint", s’interrogeait : "On en vient même à croire que le refoulement de la peine, l’interdiction de sa manifestation publique, l’obligation de souffrir seul et en cachette aggravent le traumatisme dû à la perte d’un être cher." Cette prise de conscience est encore plus forte aujourd’hui, et ce, d’autant plus qu’elle n’est pas liée à des raisons religieuses ou esthétiques ou même "antimodernes". Il y a quelques années, lors d’un colloque (auquel je participais), le ministre de la Santé de l’époque, Philippe Douste-Blazy, déclarait : "Nombre de dépressions s’enracinent dans des deuils mal faits", et, dans ce même colloque, Marie de Hennezel ajoutait : "Une dépression sur deux s’ancre sur un deuil mal fait."
Ces appréciations rejoignent les interrogations de notre ami Michel Hanus, psychiatre, président-fondateur du Comité National d’Éthique du Funéraire (CNEF), qui se demandait, sans apporter de réponses définitives, en 2006, au sujet de la crémation : "Je me pose la question de savoir si cette offense faite au corps ne rejaillit pas sur l’ensemble de la personne défunte et cette autre encore de me demander si la rapidité de la disparition corporelle ne rend pas plus difficile le vécu du deuil." La question n’est donc pas celle d’une esthétique perdue, d’une religion défunte. Elle est, avant tout, une question de santé publique quant au "vécu du deuil". Si des deuils sont "mal faits", c’est qu’il y a eu perte – et une perte d’ordre social. Nous sommes loin de la "belle mort" analysée comme un idéal perdu et qu’il faudrait retrouver pour mieux, en sous-main, revenir en arrière. Il nous faut, seulement, prendre en considération les éléments les plus efficaces pour juguler l’effet dépressif et dépréciatif du deuil. Car les deux vont ensemble. Nous vivons socialement un effet dépréciatif du deuil qui n’est pas envisagé à "sa juste valeur", qui n’est pas reconnu comme nécessaire (ou du moins sa nécessité est limitée, dans les manuels de psychologie, à deux mois en tout et pour tout), qui n’a pas toute l’importance qu’il avait autrefois. Dès lors, ledit deuil, d’une part, est limité au seul domaine du psychologique et, d’autre part, il apparaît assez vite disproportionné, exagéré, "pathologique" – et ce, donc, au-delà des trois mois accordés par le manuel américain de référence. Ce dépréciatif-là, poussé tout à la fois par la "liberté" des modernes et par la nouvelle toute-puissance de la psychologie (qui, progressivement, a fini par phagocyter le spirituel, l’émotif, le sentimental, le religieux), alimente et favorise le dépressif.
Dés lors, si nous voulons mettre un peu de sagesse dans nos vies et limiter ce double diktat (la liberté sans souci de responsabilité et la psychologie exclusive), alors demandons-nous : S’agit-il de "mourir en sujet", seul, ou faut-il bien, plutôt, accepter nos faiblesses humaines, nos fragilités psychologiques, notre besoin de reconstruction lorsque nous sommes confrontés au traumatisme de la mort d’un être cher ? Si la seconde option semble plus judicieuse, plus conforme à la psychologie des profondeurs, si des "outils" plus traditionnels, religieux ou spirituels, semblent indispensables, si le "travail du deuil" (expression affreuse mais si commode) prend plus de temps que celui accordé par nos actuels diktats de psychologie, alors pourquoi faudrait-il se refuser quoi que ce soit et se croire obligés de bâcler le travail, de l’accélérer et, les trois mois écoulés, d’avoir une sorte de mauvaise conscience d’empathie excessive ?
Damien Le Guay
Résonance n°120 - Mai 2016











Suivez-nous sur les réseaux sociaux :